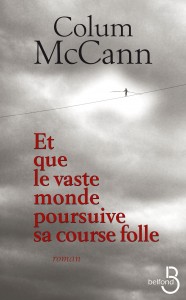Depuis longtemps, Haïti fascine. Quand la terre tremble, quand l’Etat capitule, lorsque les hommes se battent pour vivre mieux ou pour vivre seulement… Port-au-Prince et ses habitants suscitent l’intérêt jusque dans la richesse de sa littérature. Comme nombre d’auteurs haïtiens autour d’elle, Yanick Lahens puise dans son quotidien la matière dont ses livres sont faits.
Depuis longtemps, Haïti fascine. Quand la terre tremble, quand l’Etat capitule, lorsque les hommes se battent pour vivre mieux ou pour vivre seulement… Port-au-Prince et ses habitants suscitent l’intérêt jusque dans la richesse de sa littérature. Comme nombre d’auteurs haïtiens autour d’elle, Yanick Lahens puise dans son quotidien la matière dont ses livres sont faits.
« La vie tue d'abord les cœurs purs » . Au départ de l’histoire, un drame. Angélique et Joyeuse découvrent un matin que leur jeune frère Fignolé n’est pas rentré. Leur mère aussi a vu le lit fait. Militant déçu du « Parti des démunis », rêveur et musicien, il est une proie facile pour la rue. Dans un contexte apocalyptique, cette disparition est des plus inquiétantes. Les émeutes sanglantes de la veille, auxquelles il semble avoir participé, laisse présager le pire. En trente courts chapitres, incroyablement fluides et poétiques, vont s’alterner les voix de ces deux sœurs qui nous présentent, chacune à leur manière, un quotidien misérable où règne pourtant en maître le désir de survie.
Portraits. Angélique est une fille-mère de trente ans qui traîne son buste droit du banc de l’Eglise aux couloirs de l’hôpital dans lequel elle travaille. Soucieuse mais contenue, brisée mais droite, elle tente de faire vivre sa petite famille en repoussant tout ce qui pourrait agrémenter son quotidien. Sa sœur cadette, Joyeuse, représente l’engouement, la joie et la vitalité. Elle occupe une place prisée dans un petit magasin luxueux du centre ville. Grâce à son oncle, elle a pu suivre des études qui l’ont aidée à se faire une maigre place dans la société haïtienne. Dévorée par l’ambition, révoltée par son quotidien, elle contient difficilement sa colère et sa rage en toute circonstance. Contrairement à sa sœur, elle rejette toute forme d’autorité, qu’elle soit politique, culturelle ou religieuse et joue du rapport de force qu’elle instaure entre elle et les hommes par sa beauté. Toutes les deux vivent encore sous le toit de leur mère, une vieille femme que le poids des malheurs commence à voûter mais qui résiste à l’âpreté du quotidien.
Pendant la journée, chacun mènera l’enquête à sa manière : Angélique la raisonnable porte plainte auprès du commissariat et se heurte à l’incompétence des fonctionnaires dans un pays en faillite. Joyeuse fouille les affaires de Fignolé et trouve une arme, un papier avec des coordonnées téléphoniques et le nom d’Ismona, l’amoureuse de Fignolé. Mère cherche dans les rites vaudous et l’évocation des esprits les réponses que la réalité lui refuse. Si la mort de Fignolé plane sur chacun d’entre eux, aucun ne renonce à trouver la pénible vérité. Parce que se battre, c’est vivre encore. Et qu’ils n’ont rien d’autre à faire.
Une mosaïque douloureuse. Dans ce second ouvrage de l’écrivaine Yanick Lahens, les personnages n’ont pour seule réalité que les sentiments qui les animent. Mais ceux-ci ont maintes et maintes fois été partagés par les Haïtiens et prennent tout leur sens lorsqu’il s’agit de parler du quotidien de l’île. Dans sa manière de peindre une société en difficulté, où vivent des hommes tantôt vaillants, tantôt vaincus, elle s’inscrit parfaitement dans une longue tradition de littérature afro-caribéenne. Réalistes et éprouvants, ces propos sont riches d’une langue soignée, d’un rythme maîtrisé et d’une orchestration du récit parfaite. Il y a Gabriel, l’enfant innocent déjà devenu le témoin silencieux de la violence du monde dans lequel il vit, Ti-louze, la bonne noire, battue pour n’être que ce qu’elle est, John, le jeune blanc arrogant et prétentieux, porteur de toute la morale occidentale et tout aussi incapable que les autres d’apporter des solutions concrètes aux problèmes quotidiens, Mme Jacques la riche patronne de la boutique dans laquelle travaille Joyeuse, qui illustre parfaitement la classe supérieure méprisable de l’île, Lolo la jeune courtisane intéressée par « l’argent qui ouvre les frontières »…
L'auteure. Malgré sa triste réputation de pays pauvre et désorganisé, l’île d’Haïti a une longue tradition littéraire. Elle est riche d’une grande communauté d’auteurs en diaspora, telle que Dany Laferrière ou Louis-Philippe Dalembert, et regorge d’écrivains qui témoignent des réalités de leur île de par le monde. Yanick Lahens appartient à cette catégorie de la population soucieuse de témoigner de son histoire quotidienne, des aspirations déçues de sa jeunesse et de l’incroyable vitalité qu’elle abrite néanmoins. Née en Haïti en 1953, elle a effectué une grande partie de son parcours scolaire en France avant de retourner s’installer à Port-au-Prince où elle a travaillé comme universitaire, conseillère du Ministère de la Culture et écrivain. Comme le disait le poète haïtien René Depestre avant elle, « La littérature haïtienne est « au bouche à bouche avec l’histoire » ; dégager la création littéraire de la vie politique de l’île quel que soit le stade de l’histoire d’Haïti observé, n’est pas chose facile, tant la première se nourrit de la seconde, y trouve souffle et inspiration. Et jusqu'à la dernière page de ce livre, on respire avec eux.
Yanick Lahens , La couleur de l’aube, Sabine Wespieser, Paris, 2008
Extraits:
« Le quartier de tante Sylvanie est à la limite de plus pauvre encore que lui. Parce que dans cette île, la misère n’a pas de fond. Plus tu creuses, plus tu trouves une autre misère plus grande que la tienne. Alors entre Sylvanie et ce qui n’a pas encore de nom, il n’y a qu’une eau prisonnière. Gonflée de limon et de boue. A faire remonter vos viscères en boules nauséeuses. Là-bas, de l’autre côté, là où les vies tiennent en équilibre entre les pelures de tout ce qui se mange, les cadavres d’animaux, les incontinences des vieillards, les visages poisseux de morve des enfants et l’eau aigre que rejettent les estomacs affamés. A côté des chiens et des porcs, surgissent souvent des silhouettes sinistres. Le dos voûté, elles se mélangent aux bêtes. Quand elles ne leur disputent pas les restes, elles fouinent furtivement à leurs côtés dans la puanteur et la pourriture des immondices. » [1]
« Quand en fin d’après-midi, il est revenu à la maison, un poste de télévision posé sur la tête, je l’ai vertement réprimandé. […] Et à mesure que ma colère s’endormait, j’ai regardé Fignolé avec une admiration qui m’a moi-même surprise. Au fond de moi un feu étrange s’est mis soudain à crépiter. Et j’ai senti qu’il crépitait parce que je l’approuvais. Oui, je l’approuvais. Je compris ce jour-là qu’il y a de quoi devenir méchant quand on est asservi. Quand la vie est sans issue pour vous et tous ceux qui vous ressemblent depuis le commencement du monde et qu’un homme, un jour, une fois, vous indique une sortie. Alors si étroite, si basse, si sombre soit-elle, vous vous y engouffrez. Tête baissée. Et j’ai baissé la tête. » [2]
[1] Yanick Lahens,
La couleur de l’aube, Sabine Wespieser, Paris, 2008, p. 50.
[2] Yanick Lahens, La couleur de l’aube, Sabine Wespieser, Paris, 2008, p. 59.