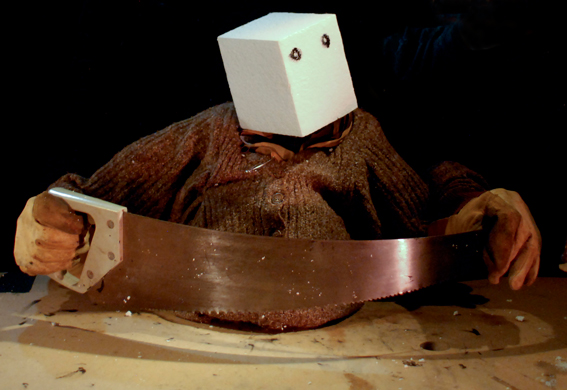Les pauvres heures de Thibault et Mathilde
Les Heures souterraines débutent tôt, le matin du 20 mai. Mathilde (Anne Loiret) est prise d’insomnie à cause de ses problèmes au travail. Thibault (Thierry Frémont) est médecin à domicile. Dans une chambre d’hôtel sur la côte où il a passé le week-end, il réfléchit à comment quitter Linda, jeune fille de 28 ans qui, à son grand désespoir, n’est visiblement pas amoureuse de lui. Une voyante a prédit à Mathilde que ce jour-là, il lui arrivera quelque chose de fort. Thibault reprend ses tournées, supportant de moins en moins la solitude dans laquelle baignent ses patients, probablement parce qu’elle est le miroir de la sienne.
La désespérance lie ces deux vies où « il faut que quelque chose se passe », pour trouver une raison de tenir debout. Chacun de leur côté, ils tentent de refaire le chemin qui les a mené dans cette situation banale. Une situation qui se répète depuis des centaines de jours, tous les mêmes. Ce 20 mai est la journée où Thibault et Mathilde réfléchissent sur la difficulté de supporter leur propre existence.
Le duo d’acteurs joue bien la détresse ordinaire, malgré une voix amplifiée au microphone qui n’est pas nécessaire dans la petite salle Réjane du Théâtre de Paris. Celui-ci installe une distance incompréhensible entre le public et les comédiens, il frotte contre les vêtements, créant de nombreux grésillements. La mise en scène d’Anne Kessler met en lumière les réflexions successives de cet homme et de cette femme dans un espace impersonnel qui peut être tantôt un restaurant japonais, bureau, chambre ou bien quai de métro. L’utilisation réaliste de la vidéo termine de peindre le décor de chaque scène. Des scènes qui comparent deux réalités communes, deux personnes qui se cherchent sans le savoir, une rencontre probable qui ne se fera jamais, ni en personne, ni en esprit.

Mais pour le public, une question naît : va-t-on au théâtre pour voir sa propre vie sans aucune distance ou esprit critique ? La scénographie reprend les carreaux blancs d’une station de métro, les problèmes, les questions des personnages sont celles de tout un chacun. Les Heures souterraines représente le monde qui nous entoure, rien d’autre. On assiste à une tentative gentillette de la part de Mathilde et Thibault, de lutter contre une vie socialement acceptable sans pour autant brusquer le spectateur, telles des personnes qui se disent soucieuses de l’environnement et qui prennent leur voiture pour aller acheter du pain dans le quartier. Ici, Delphine Le Vigan montre ce que le public de théâtre à Paris peut vivre chaque jour et cela sans le moindre recul. On se surprend à imaginer que, si l’on invitait un ami cadre supérieur quadragénaire un peu dépressif à boire une bouteille de vin un soir, son discours serait peu ou prou celui que tiennent les personnages des Heures souterraines.
Le texte est narcissique, non pas qu’il raconte la vie de Delphine Le Vigan : comment le savoir ? Mais il est narcissique pour le public qui y assiste, pour celles et ceux qui vont se retrouver dans ces personnages et qui penseront que cela les aura fait réfléchir. Tous les gestes sont détaillés : la liste de courses, la réunion « planning », la rencontre dans un bar et les 4000 euros par mois. En somme, les détails de la vie les moins dignes d’intérêts sont étalés dans cette suite de monologues sans fond. Relevons néanmoins quelques moments de cynisme et de désabusement dans lequel sombrent les personnages : comme devant un téléfilm, on ne s’ennuie pas. On est malheureusement très loin du niveau d’une Annie Ernaux qui, pourtant, créé les mêmes sortes de personnages mais dotés d’une profondeur dramatique bien plus importante et donc universelle. Avec Les Heures souterraines, Delphine Le Vigan semble avoir trouvé et édité le journal intime d’une cadre de grande agence de communication, une pièce qui aurait pu tout aussi bien être composée d’un digest des meilleurs dossiers de Psychologie Magazine.
Cependant, l’histoire ne finit pas comme l’on pourrait s’y attendre. Les personnages ne transcendent pas cette fatalité dans laquelle ils s’enferment et ont conscience d’être enfermés. Leur vie se résume à leur travail, mais ils veulent s’en sortir, comment faire plus banal ? Oui, cela pourrait être nous. Mais après ?
« Les Heures Souterraines » de Delphine Le Vigan. Mise en scène d’Anne Kessler, actuellement au Théâtre de Paris, 15 rue Blanche, 75009, Paris. Durée : 1h20. Plus d’informations et réservations sur www.theatredeparis.com.