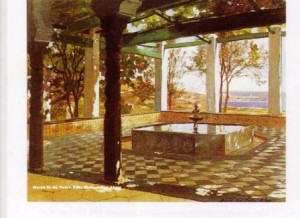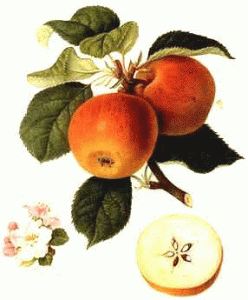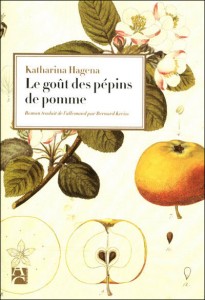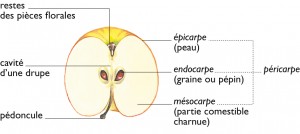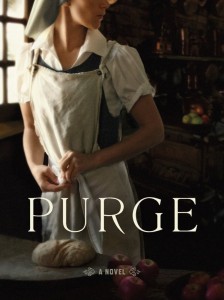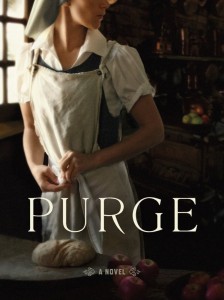
Dressons rapidement le tableau. En toile de fond, des territoires ruraux et bucoliques piétinés sans détour, tour à tour par l’Allemagne d’Hitler puis l’URSS de Staline. Au milieu, des Estoniens et des Estoniennes qui survivent, luttent, se révoltent ou s’inclinent. C’est l’histoire d’une rencontre, une histoire de famille mais avant tout, l’histoire d’un pays balte: l’Estonie. Il plane sur ces pages l’ombre d’un autre monde, le bloc de l’Est. Rien de bien réjouissant en somme… Cependant ce livre est une petite merveille.
L’écriture de Sofia Oksanen est brutale. On n’entre certainement pas dans l’histoire comme on entrerait dans une maison de famille douillette où l’on retrouve ses chaussons. On doit s’accrocher aux personnages, on se heurte à leurs destins chaotiques, on se bat pour recoller aux bribes de l’histoire de l’après-guerre. Et puis, avant qu’on ait eu le temps de s’en rendre compte, on est coincé dans le terrible engrenage invisible qu’on croyait pourtant propre aux polars.
La narration est alternée et décapante, moitié à l’Est moitié à l’Ouest. Les chapitres ont des titres à rallonge aussi évocateurs que « C’est toujours la mouche qui gagne », ou « Aliide avale un lilas à cinq pétales et tombe amoureuse », ou encore « Un passeport, ça se met dans la poche intérieure ».
Aliide et Zara, des prénoms pas communs, pour des héroïnes peu conventionnelles. Ces deux femmes que deux générations séparent ont en commun un destin bouleversé par la folie des hommes. Leur rencontre est un choc, quasiment une rencontre du 3ème type. Le face à face de ces deux femmes est un huis-clos oppressant. Au fur et à mesure que l’on remonte dans le temps, on comprend la haine, la rage, la jalousie, la rancœur, la douleur et la peur. On assiste, impuissant, à la naissance d’un tyran malgré elle dans un pays déshonoré. Une tragédie moderne et puissante comme on en rencontre rarement.
Aliide n’est pas une méchante au rire diabolique qui retentit jusqu’aux confins de l’enfer mais elle est implacable.
Zara, elle, est innocente, peut-être aussi inconsciente.
Alors, purge-t-on le bébé ? Oui c’est sûr.
Jette-t-on le bébé avec l’eau du bain ? Sûrement pas !
L’auteur

Sofi Oksanen écrit en finnois, son père est finlandais et sa mère estonienne, elle a peut être reçu de celle-ci l’amour de ces terres méconnues. Passionnée de Marguerite Duras, cette trentenaire ne fait pas mentir l’adage qui dit que « L’habit ne fait pas le moine ». La plume a beau être rigoureuse et le style recherché, Sofia Oksanen est une punk au look anticonformiste. Qui l’eût cru ?
Prix Femina étranger en 2010 et véritable best seller, son troisième roman remue, secoue, bouleverse et fait découvrir une partie obscure de l’Histoire.
Au même titre que le personnage de « Grenouille » de Patrick Süskind ou que le personnage Dexter de la série américaine éponyme, vous n’êtes pas prêt d’oublier Aliide Truu.
Extraits
« 1991, BERLIN
La photo que Zara tient de sa grand-mère
Sur la photo, deux jeunes filles étaient assises côte à côte et regardaient fixement l’objectif, sans oser lui sourire ? Leurs robes qui tombaient sur les hanches étaient un peu bizarres. L’ourlet de l’une des filles était plus haut à droite qu’à gauche.[…] Et tandis que Zara observait la photo, elle remarqua quelque chose qui lui avait échappé jusque-là : les visages des filles avaient quelque chose de très innocent, et cette innocence rayonnait sur leurs joues rondes jusqu’à elle si bien qu’elle se sentit gênée. » [1]
« 1952, ESTONIE OCCIDENTALE
L’odeur du foie de morue, la lumière jaune de la lampe
L’odeur du chloroforme flottait par la porte. Dans la salle d’attente, Aliide se cramponnait à un numéro tout corné de Femme soviétique, où Lénine était d’avis que la femme, dans le capitalisme est doublement soumise, esclave du travail ordinaire du capital et du travail domestique. » [2]
[1] « Purge » Sofi Oksanen, édition la Cosmopolite chez Stock (2010) , p114
[2] « Purge » Sofi Oksanen, édition la Cosmopolite chez Stock (2010) , p265