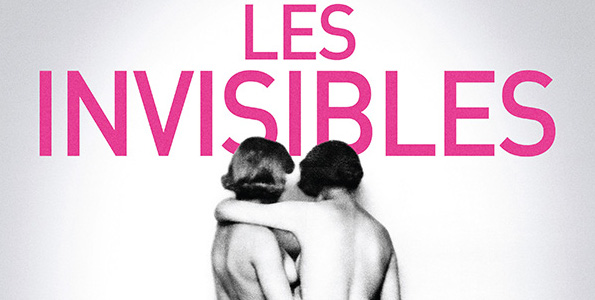Yves Jeuland nous a habitués à mettre son service au talent de la politique française [1. Il a réalisé, entre autres, « Camarades, il était une fois les communistes français » (2004), « Un village en campagne » (2008), « Le Président » (2010). Ce dernier porte sur la campagne de Georges Frêche pour conquérir la région Languedoc-Roussillon.], la livrant telle qu’elle est aux yeux du spectateur, souvent cruelle et manipulatrice. Avec « Delanoë libéré », c’est un autre exercice auquel se consacre le réalisateur, puis qu’ici, il se donne une place (corps et voix) au casting. Il est installé avec Bertrand Delanoë dans un studio de tournage (bien que toujours de dos), et c’est lui qui mène l’entretien avec celui qui, en mars 2014, portera le titre (honorifique!) d’ancien maire de Paris.
Le contexte est intéressant : le maire socialiste (le premier à Paris depuis 1 siècle !) ne se présentera pas à sa succession [2. La candidate du Parti Socialiste est une « lieutenant » de Bertrand Delanoë, Anne Hidalgo.], il est « libéré » d’engagements futurs et peu donc dresser une sorte de bilan. Une « sorte », car ce n’est pas un bilan politique qu’il faut s’attendre à voir ici, encore moins un bilan de mandat. Quel intérêt à dresser ce dernier pour soi-même si ce n’est pas pour être réélu ? C’est donc un bilan humain qui s’écrit pendant ce film, comme le récit d’une vie, d’un homme, de ses souvenirs, avant son retrait de la vie publique.
Jeuland n’en est pas à son premier documentaire où Delanoë a un rôle important. Il y a douze ans, il tournait un film baptisé « Paris à tout prix ». Diffusé en deux épisode sur Canal+, il montrait tout de la bataille que les candidats se livraient entre eux pour l’Hôtel de Ville. Ce documentaire s’arrête sur la proclamation des résultats. La caméra était restée à l’entrée, elle a attendu patiemment la sortie. C’est d’ailleurs avec plusieurs images de ce premier documentaire que s’ouvre « Delanoë libéré ».
Filmé de trois-quarts on voit monsieur le maire regarder les images, on profite ainsi de ses réactions. Il donne l’apparence d’un homme simple, au regard fatigué, sans être agacé, qui est assis face à nous. Fait rare pour un homme politique : il s’exprime en bon français, dans cette voix grave de fumeur de cigarillos couronnée d’une légère intonation de dandy, que même l’auditeur occasionnel lui connaît. On le voit en ami de Lionel Jospin, admirateur de Gaston Defferre, inséparable de Dalida… Cette dernière qui l’accompagnait dans les rues du 18e arrondissement au soir de sa première élection en tant que député pour fêter la victoire en 1981.
C’est un vieux combattant qui porte maintenant un regard façonné par la maturité et l’expérience sur sa propre vie. Une naissance à Bizerte en Tunisie, son mai 68 à Rodez, sa montée à Paris quand il avait 24 ans et les engagements menés alors. Il parle des leçons données par ses parents, qui n’ont pas connu son ascension brillante. L’occasion pour lui de revenir sur l’un de ses grands combats face à lui-même : contre l’orgueil, un vieux démon dont il donne l’image de s’être complètement libéré aujourd’hui. Il commente aussi son coming-out, réalisé à fin des années quatre-vingt dix et se félicite du fait qu’aujourd’hui « le maire de Paris soit homosexuel, et que tout le monde s’en foute ! ». Il assume son célibat, ou plutôt, sa liberté encore une fois, confessant que jamais « [il] ne veut se priver d’une affection naissante ». La liberté, véritable luxe de cet homme sans téléphone portable, peut-être…
Il y a aussi une certaines douleur et peut-être un peu de regret quand il revient sur ses échecs internes du parti Socialiste. Fataliste, il commente : « c’est que cela ne devait pas arriver ». Douleur également, mais philosophie aussi, quand il repense à la tentative d’assassinat dont il a été victime à l’Hôtel de Ville ce samedi soir de 2002, lors de la première édition des Nuits Blanches, il dira qu’il « se peut que cela [lui] ai apporté un peu de sagesse ».
Enfin, la question de savoir, pourquoi il s’arrête là ? Alors qu’il aurait tout a fait pu être réélu si cela l’avait intéressé ? [3. Bertrand Delanoë avait annoncé dès son élection qu’il n’exercerai que deux mandats à la tête de Paris.] Delanoë répond qu’il a « admiré deux grands maires : Defferre et Chaban-Delmas, et que ces deux ont fait quelques mandats de trop ». Il préfère donc penser à l’après mars 2014, imaginant sa vie entre « voyages, plage et copains », sans pour autant écarter toute possibilité de responsabilité politique, disant en substance que si on lui confiait une « mission », il ne la refuserait peut-être pas…
Comme à son habitude, Yves Jeuland et son équipe ont le génie pour faire voir l’humanité dans le héros et comment celui-ci arrive, d’une certaine manière, à nous le faire aimer. Ils construisent une histoire autour de ce sujet qui ne semble pas forcément évident au départ. Et pourtant, on comprend tout. On s’intéresse à chaque minute du film même si on ne connaît pas grand chose de l’homme au départ [4. C’est le cas de l’auteur de cet article.]. Le mélange entre images d’archives, interview et clins d’œil musicaux (chers à Jeuland) donne un bel équilibre à l’ensemble, on ne relève pas de longueurs ou de détail qui viendrait en gâcher l’harmonie.
Ce documentaire mérite l’attention du spectateur amateur ou non de jeux de pouvoirs. Il offre l’image intéressante d’un homme politique peut-être un peu plus vrai que les autres ? Assurément vrai, car (volontairement) libéré !
« Delanoë libéré » sera diffusé le 18 octobre sur France 3 à 23h10