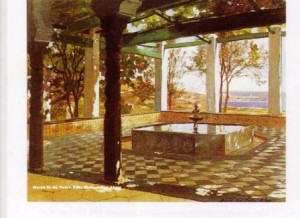[Théâtre] Entre passé et présent campent « Les Oubliés (Alger-Paris) »

À travers des histoires de famille enfouies, le Birgit Ensemble fait entendre les voix tristes et belles des effacés de la grande Histoire. Grâce à un récit situé entre la guerre d’Algérie et 2019, ce spectacle échappe adroitement aux discours mielleux et misérabilistes.
De manière apaisée, Julie Bertin et Jade Herbulot abordent des épisodes fondamentaux de cette décolonisation de l’Algérie, embarrassante pour la France. Les bidonvilles à Nanterre dans les années 1960, les exilés de la guerre, le sort tragique des harkis après l’indépendance, du 5 juillet 1962. Ces traumatismes sont portés à la scène sous forme de secret de famille. Et c’est par un mariage en 2019 que le tout, bien ficelé, va exploser aux visages de ceux qui portent, sans le vouloir, ce passé enterré.
Car Karim et Alice se marient. Tous les deux sont français, lui, est d’origine algérienne. Judith Benhaïm, la maire qui les unit est juive, elle aussi d’origine algérienne et se réjouit de ce métissage, dans son discours aux époux. A priori, tout le monde est content. A part peut-être le père de la mariée, carrément raciste, qui ne se rappelle pas du prénom de son gendre. Alors ça va péter. Parce que ça boit, ça bouffe et forcément ça déborde. Remontent à la surface des origines cachées, des souffrances enfouies et des non-dits terribles.
Face à face
Au milieu de la salle : la scène. Assis de part et d’autre, les spectateurs peuvent se voir. De même que les personnages doivent regarder dans les yeux leur roman familial, le public comprend une histoire différente de celles que racontent les programmes scolaires. Le Birgit Ensemble délivre ainsi un propos, pédagogique et efficace, sur la guerre d’Algérie, la mémoire, la patrie. Un spectacle qui ne manque pas de nous toucher ; sans que l’on s’y attende, sans que l’on s’en aperçoive.
« Les Oubliés (Alger-Paris) », texte et mise en scène du Birgit Ensemble, formé par Julie Bertin et Jade Herbulot.
Durée : 2h10
Jusqu’au 10 mars, à la Comédie-Française, Théâtre du Vieux-Colombier.