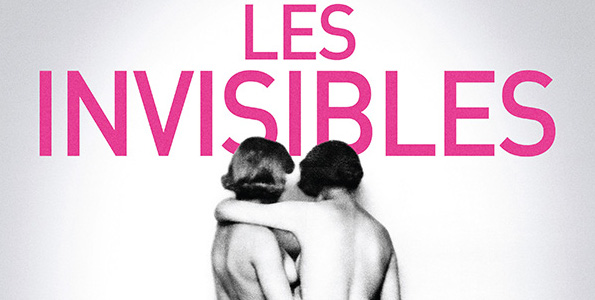[Cinéma] Entretien fleuve au cœur de Nostos Algos

Jeune réalisatrice, Ysé Sorel montre déjà sa patte au Festival International du Film Indépendant de Bordeaux. Dans la compétition « Contrebandes », qui présente uniquement des premiers métrages auto-produits, Nostos Algos retient notre attention. Ce film est un voyage dans la vie de Yorgos, un Crétois qui retourne sur sa terre natale en crise économique. Ysé Sorel raconte comment la nostalgie a guidé un travail qui semble fasciné autant par un territoire que par ceux qui l’habitent.
Arkult.fr : Après la philosophie et le théâtre, comment en êtes-vous arrivée au cinéma ?
Ysé Sorel : Par surprise, car je n’y était pas attendue. Je ne l’ai pas étudié, ce qui d’ailleurs me permet une grande liberté. Je me méfie de l’uniformisation des écoles, cela me ferait perdre toute la liberté que j’éprouve dans le médium cinéma. Et puis j’ai assez fait d’études comme cela!
Arkult.fr : Justement, comment vous êtes vous servie de vos études dans ce premier long métrage?
Ysé Sorel : J’ai pensé ce film comme un essai philosophique sur la nostalgie. J’ai simplement trouvé d’autres moyens de m’exprimer : les images, le son… Je n’aime pas uniquement les films qui convoquent la philosophie, mais c’est un cadre que j’avais envie d’explorer. D’ailleurs je m’y sens bien.
« Où je vais ? Qu’est-ce que je veux faire ? Des questionnements intimes autant qu’universels »
Arkult.fr : En quoi Nostos Algos est-il un film personnel ?
Ysé Sorel : Je raconte la crise de Yorgos, le personnage principal, qui soulève des questions aussi intimes qu’universelles je pense. Je les suggère à l’écran avec des couvertures de livres qui m’ont accompagnés, parfois même tourmentés. Où je vais ? Qu’est-ce que je veux faire ? Toutes ces incertitudes me parlent d’autant plus que c’est un film d’apprentissage. Dans ce sens qu’il raconte un personnage qui se cherche, dans un pays qu’il a quitté et qui demeure en crise. Mais également puisque j’ai appris à faire du cinéma en réalisant ce projet.

Arkult.fr : Tous les personnages jouent leur propre rôle. Comment gère-t-on cette distance propre à l’auto-fiction ?
Ysé Sorel : Faire son miel avec le pollen de vraies existences sans tomber dans le vampirisme est extrêmement complexe. Je me suis beaucoup posée la question car ce film est à la frontière entre le documentaire et la fiction. Je crois ne pas avoir céder à cette tentation vampiriste. Parfois Yorgos a dû me donner beaucoup, et cela lui a coûté. Mais il a accepté de devenir cette surface : le personnage principal.
Arkult.fr : Qu’est-ce qui se joue dans la scène du premier repas en famille ?
Ysé Sorel : Il n’y a que du pain dur sur la table, et l’on comprend que c’est la crise. Mon but n’était vraiment pas de faire un film les difficultés économiques de la Crète. On les saisit par endroits mais j’ai juste voulu parler d’une famille, prise dans cette tourmente là. Cette histoire de pain dur rends la chose plus juste. Ce moment d’émotion fait partie des cadeaux qu’offre le documentaire. Bien sûr cela est mis en scène, mais ce sont de vrais gens qui jouent leur propre rôle, alors c’est très touchant.

Arkult.fr : Le calme qui règne dans votre film s’est-il imposé par ce que vous avez vu sur place ou c’est une pure construction ?
Ysé Sorel : J’ai vraiment ressenti cela là-bas. La nostalgie réside aussi dans cette tranquilité. La Crète est un territoire assez particulier par rapport à la Grèce, il s’y dégage une atmosphère rassurante. Certains ne croient pas à la crise, de par l’absence de tumulte. Un des personnages dit même qu’elle n’existe pas. Avec son fromage et ses tomates il ne manque de rien. C’est une vraie leçon de vie.
« J’aime être nostalgique car c’est une douceur, un peu comme ce voyage. »
Arkult.fr : Nostos Algos en grec signifie « nostalgie ». Quelle serait votre définition de la nostalgie ?
Ysé Sorel : Pour moi ce serait ce film. La nostalgie est un sentiment que l’on ressent plus ou moins. Comme un souvenir de l’enfance ou de toutes petites choses : une odeur, une photo, une sensation qui souvent nous échappe… À mes yeux c’est la conjonction entre un moment et un lieu qui ont marqué notre vie. La recherche de nostalgie est de l’ordre de l’insaisissable. J’y vois une forme de beauté qui me touche beaucoup. J’aime être nostalgique car c’est une vraie douceur, un peu comme ce voyage.

Arkult.fr : Vous filmez beaucoup d’images fixes. Quelle place tient la photographie dans votre travail ?
Ysé Sorel : Je la pratique de plus en plus, plutôt sur pellicule. J’ai donc un rapport très graphique à la manière de filmer. Les natures mortes en peinture m’inspirent d’ailleurs beaucoup. Je crois que je mets à l’épreuve mon oeil dans ces détails. J’essaie de donner au spectateur une forme de liberté pour qu’il puisse investir ses propres souvenirs dans les images que je montre.
Arkult.fr : « Quelle dose de pays natal vous faut-il ? » est une question que vous posez, alors on vous la retourne…
Ysé Sorel : Barbara Cassin le dit de manière très juste dans son ouvrage La Nostalgie : « On est chez soi quand on est accueilli ». J’ai tellement ressenti ça en Grèce que j’aimerais trouver le moyen d’aller habiter là-bas. Ce n’est pas mon pays natal car je me sens très française mais j’ai besoin de cet endroit, de sa simplicité.

Propos recueillis par Philippine Renon.