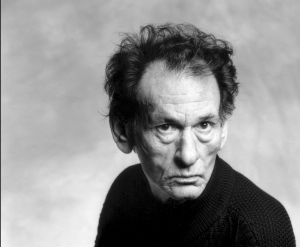Dans la peau de Peter Handke
Laurent Stocker, prêté pour l’occasion par la Comédie-Française, incarne dans la nouvelle mise en scène d’Alain Françon, le héros vivant d’une histoire de fantômes. Moi (c’est comme cela qu’il s’appelle), tente de reconstituer son passé familial. D’abord en arrière-plan ; puis, peu à peu, la frontière s’étiole jusqu’à la scène finale où Moi échange directement avec son oncle sur l’histoire telle qu’elle est vécue, et sur la façon dont elle est retenue.
La « tempête » du titre, c’est la zizanie puis la guerre. Ce sont les différents points de vue sur la perte du pays natal et de la langue propre à l’identité d’un peuple, ignorée puis interdite par l’envahisseur – le slovène. En 1936, la famille de Moi vit l’invasion de la Tchécoslovaquie par l’armée allemande. Il y a les garçons (les oncles de Moi), qui seront d’abord engagés de force avant que deux d’entre eux ne meurent au front, Benjamin et Valentin. Le plus âgé, Gregor, rejoindra sa sœur dans la résistance, niché dans les forêts surplombant la Carinthie (actuel sud de l’Autriche). Les grands-parents se retrouvent seuls : leur dernière fille, mère de Moi, est partie avec son bébé dans ses bagages à la recherche de l’officier allemand qui l’a mise enceinte en 1942. On pense à tous les peuples dispersés par une géopolitique qui a choisi, au mieux, de les ignorer et au pire de les pourchasser comme les Kurdes ou les Arméniens.
L’histoire de Handke, largement autobiographique, met en avant une notion chère à l’auteur : l’importance de la multiplicité des points de vue dans la construction de la vérité historique. C’est lui qui avait fustigé les critiques à son encontre lorsqu’il était apparu à l’enterrement de Slobodan Milošević en 2006, arguant que « Le monde, le soi-disant monde, sait tout sur Milošević. Le soi-disant monde connaît la vérité » ; sous-entendant par l’ironie que l’on avait pas laissé à une autre vérité la possibilité d’émerger.
Cette confrontation entre un jeune et ses ancêtres – autrement plus profonde qu’une chanson des Enfoirés – donne lieu à ce qui s’apparente à du théâtre historique, où histoire vécue et histoire analysée sont exposées. A plusieurs reprises, les aïeuls clament pour justifier leurs actes honorables et courageux : « l’Histoire nous donnera raison ». Il y a une confiance solide en la mémoire à venir que ne partage pas Moi. Aussi, il est très intéressant pour nous, public français, de découvrir comment cette famille vit l’armistice du 8 mai 1945 et comment l’allégresse et la paix sont presque aussitôt sapées par la Guerre Froide qui débute.
Quelques touches d’ironie viennent alléger ce texte linéaire qui semble allongé de façon artificielle, notamment au début et à la fin. On entre dans le vif du sujet après une longue présentation de la famille et de ses habitudes – en beaucoup de mots pour dire peu de choses. Pénétrer aussi profondément dans leur intimité pour ensuite avoir une approche reculée de l’histoire, est-ce vraiment nécessaire pour le spectateur ? L’intellectualisation de ce qui pourrait être un banquet de famille, est-elle vraiment intéressante ? On pourrait aisément se passer des longues litanies sur les différentes variétés de pommes ou bien les menus complets avant que la famille ne passe à table. Et cela sans commenter le caractère discutable de la traduction (on pense à Gregor qui emploie l’expression erronée « au jour d’aujourd’hui », ou à cette phrase d’une qualité littéraire douteuse : « les hommes meurent et les t-shirts perdent leurs couleurs »).
Les acteurs relèvent le niveau. Laurent Stocker est bouleversant de justesse. On pense aussi à Dominique Reymond, qui prend ici les traits d’une jeune mère joviale et confiante. Dominique Valadié est étonnante et le couple de grands-parents, joués par Nada Strancar et Wladimir Yordanoff, est particulièrement touchant.
Comme l’auteur le désirait, Alain Françon met en scène la pièce de façon concrète et réaliste. Installés sur une scénographie en pente – qui nous rappelle étrangement celle réalisée pour Les Gens d’Edward Bond –, les personnages évoluent sur une steppe aride, sans que jamais la mise en espace ne nous surprenne. Tout le soin a du être apporté à la direction des acteurs, tellement Françon se fait ici le chantre d’un classicisme inassumé, signant ainsi une mise en scène terne, peu compréhensible quand on incarne un homme si important dans l’histoire du théâtre.
C’est donc mitigé que l’on sort des trois heures vingt que durent la représentation. Une idée intéressante, un point de vue novateur et de grands comédiens, dans un texte malheureusement long et gonflé, où l’ennui prend corps à de nombreuses reprises.
Hadrien Volle
hadrien (a) arkult.fr
« Toujours la tempête » de Peter Handke, mise en scène d’Alain Françon, jusqu’au 2 avril 2015 au Théâtre de l’Odéon (Ateliers Berthier), 1, rue André Suares, 75017 Paris. Durée : 3h20 (avec entracte). Plus d’informations et réservations sur www.theatre-odeon.eu