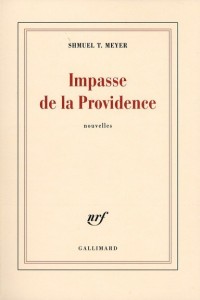Avignon IN 2016 – Collection Lambert : « Yitzhak Rabin : chronique d’un assassinat » : l’œuvre fait preuve

Le 4 novembre 1995 à Tel-Aviv, après avoir prononcé un discours à l’occasion d’une manifestation pour la paix, Yitzhak Rabin, alors premier ministre d’Israël, est assassiné à bout portant de deux balles dans le dos par un étudiant juif israélien opposé aux accords d’Oslo conclus en 1993 à Washington. Depuis 2015, l’architecte et cinéaste israélien Amos Gitaï travaille sur cet événement qui a enterré le dialogue entre Israël et Palestine et a durablement marqué l’histoire du Moyen-Orient.
C’est d’abord par la réalisation d’un film-enquête intitulé Le Dernier jour d’Yitzhak Rabin présenté à la Mostra de Venise et au Festival international du film de Toronto l’an passé que le travail de Gitaï a pris forme. À Avignon depuis le 3 juillet, le regard porté sur la mort du prix Nobel de la paix de 1994 trouve sa continuité et évolue sous la forme d’une exposition à la Fondation Lambert qui se tient jusqu’au 6 novembre, et qui porte le même titre qu’un spectacle présenté à la Cour d’Honneur du Palais des Papes le 10 juillet : « Yitzhak Rabin : chronique d’un assassinat ». Sous forme de triptyque et par un recours à tous les arts mêlant le documentaire à la fiction, Amos Gitaï construit une œuvre critique profondément engagée, universelle et optimiste, en grande partie élaborée à partir des souvenirs de Leah Rabin, la veuve de Yitzhak.
Fils de Munio Gitaï Weinraub, Amos Gitaï reconnaît avoir été influencé par les « perceptions artistiques » de son père qui était architecte mais surtout juif, il s’était fait expulser d’Allemagne par les Nazis en mai 1933 alors qu’il étudiait au Bauhaus à Dessau, son fils en a fait un film sous forme de diptyque plus largement consacré aux deux parents entre 2009 et 2012. S’il a fait des études d’architecture et suivi les traces de son père, c’est après s’être engagé dans la guerre du Kippour en 1973, où il est blessé par un missile syrien, qu’il se lance dans la réalisation de documentaires. Rapidement, ses travaux sont marqués par des recherches théoriques et expérimentations formelles avec la caméra auxquelles il renonce dans ses œuvres consacrées à Yitzhak Rabin. Fasciné par la reconstitution d’une mémoire à partir de fragments d’histoire, Amos Gitaï entend refléter à travers des prismes artistiques aussi différents mais peu éloignés que le film documentaire, le théâtre et les arts plastiques l’impact de l’assassinat politique de l’homme d’État. Pour l’artiste, le parti pris est constant aux trois propositions, il faut installer une relation entre tous les documents qui ont servi aux recherches, à savoir la vidéo, des éléments sonores, des toiles, des sculptures de céramique, des témoignages, des correspondances… Amos Gitaï n’envisage pas une œuvre d’art sans son contexte, il écrit d’ailleurs ceci « Je comprends qu’il n’est pas possible de faire un travail artistique sans contexte. Sans contexte à la fois artistique et politique ». Alors que le film, long de près de trois heures, est un montage d’images d’archives, de manifestations, d’interviews et de scènes reconstituées par des acteurs, l’hommage continue dans une forme similaire sur les planches.
« Yitzhak Rabin : chronique d’un assassinat » a effectivement été le fait d’une seule et unique représentation le 10 juillet au soir, à l’occasion du Festival d’Avignon qui cette année plus que jamais revendique un choix de spectacles très politiques en prise avec l’actualité comme avec Les Damnés, Ceux qui errent ne se trompent pas en proposant tout particulièrement un focus Moyen-Orient avec des pièces comme Alors que j’attendais du metteur en scène syrien Omar Abusaada. Sur l’immense scène de la Cour d’Honneur et sur un mode récitatif, Amos Gitaï a mis en scène le récit de l’assassinat à partir d’une fable très factuelle saisissante de sobriété et de retenue portée par l’actrice israélienne Hiam Abbass et la française Sarah Adler, qui avait déjà collaborée avec le réalisateur en 2014 pour Tsili. Assises autour d’une table imposante qui renvoie l’image d’un bureau ministériel, les actrices semblent lire un manuscrit qu’elles ne lâchent pas, même lorsqu’elles se lèvent et ne bougent plus lors de la scène finale. Porté par une voix si grave et l’accent arabe de Hiam Abbass, le texte prend vie, résonne et se heurte à des images d’archives du fameux jour de l’assassinat de Yitzhak Rabbin ainsi que de manifestations pour et contre la réconciliation d’Israël et de la Palestine projetées sur tout le mur du Palais des Papes surmontant la scène. Noyé dans ces images silencieuses, le public est simultanément interpelé par deux musiciennes jouant du violoncelle et du piano ainsi que par un chœur foulant sans cesse une platebande de graviers pour un effet sonore tout à la fois captivant et écrasant. Poignant mais toujours esthétique et poétique, le spectacle qu’Amos Gitaï est venu présenter en personne avant la représentation n’est jamais seulement documentaire, si bien que l’hommage trouve naturellement son écho dans l’exposition présentée à la Fondation Lambert en Avignon.

Arrivé au pouvoir en tant que premier ministre et chef du parti travailliste en 1992, Yitzhak Rabin avait encouragé, conjointement avec Bill Clinton, une autonomie palestinienne à peine un an plus tard. Mais dans la foulée, bien que les accords signés par Rabin aient été historiques, les partis d’extrême droite ont déstabilisé le pouvoir et perpétré de nombreux attentats à l’encontre de Rabin. Deux mois avant d’être assassiné et remplacé par Benyamin Netanyahou qui veut maintenir Israël au contrôle permanent de la Cisjordanie, Yitzhak Rabin prévoyait un découpage de territoires palestiniens remettant en question les zones de contrôles d’Israël. Le projet n’aboutira pas, de nombreuses théories du complot ont d’ailleurs été avancées concernant le jour de l’assassinat, et le rapport qui avait réuni plus de 4000 témoignages réalisé à l’issue de l’événement n’a jamais été entièrement publié. Si la pièce de théâtre était centrée sur l’homme d’État et de paix, l’exposition mêle davantage la fiction en s’annonçant dès l’entrée comme un « geste artistique inspiré d’un événement traumatisant ». À travers trois grandes salles sombres aux fenêtres condamnées, la scénographie est répétée à l’identique sur un mode ternaire. Le plus frappant vient du fait que le public est plongé dans une ambiance sonore qui ne laisse aucune chance au silence là où l’espace lui, célèbre le vide et l’obscurité ; comme au théâtre, une tension subsiste entre documents papiers et vidéos, réels et fictionnels.

Pour faire de la mémoire un agent du changement, Amos Gitaï a couvert les murs de photographies de grands formats donnant à voir des mouvements de foules floutés en noir et blanc, toutes portent le titre de « chronique fragmentée », toutes sont une pièce d’un puzzle politique morbide. Chaque salle participe à la reconstitution de l’assassinat et fait penser à une place vide prête à accueillir une manifestation, tout en faisant répondre à ces photographies sous vitres reflétant le visiteur comme invité à prendre part au mouvement visuel et sonore, un écran géant où des images sont projetées à grande échelle. Dans ce chevauchement sensoriel, les images prennent vie et les sons deviennent visuels, véritable acteur, le visiteur est confronté à ces œuvres qui font preuves. Le rôle et la force des images est d’autant plus mis en question qu’en dessous de ces mouvements anti-Rabin et Palestine sont présentées deux vitrines dans lesquelles des petites figurines de céramique sont elles-mêmes filmées et superposées aux images d’archives, ces petits bonhommes incarnent pour leur part une marche pour la paix qui ne bouge pas, ils sont des « Demonstrators at the peace rallye ». Face à ces modèles réduits anthropomorphiques blanchâtres comme englués là, restés coincés en 1995, on est appelé à envisager la paix comme toujours possible, toujours dormante. Aux mots et beaux discours se heurtent des révolutions silencieuses, le message d’Amos Gitaï est plein d’espoir : et si les gestes artistiques devenaient aussi forts que les balles ?
À retardement, l’art pourrait ressusciter la mémoire, entamer des mouvements et face à un pouvoir qui condamne ce qu’il considère comme dissident, Amos Gitaï propose de condamner le pouvoir, d’élaborer une stratégie sensorielle et artistique totale qui changerait la réalité. À travers cet espace d’exposition, un soulèvement semble urgent face à la reconstitution de cette histoire stagnante et la monstration des étapes de dégradation de l’événement. L’artiste a conscience qu’il ne s’agit pas du plus grand conflit du monde, là où les médias se sont tus, l’art se réveille et en restitue la force symbolique. Israël n’est pas seulement un territoire en conflit permanent, c’est aussi un lieu qui a vu naître trois religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l’islam, occupé par une politique de mitraillettes. Que ce soit face au film, au spectacle ou dans cet espace d’exposition, le public est certes nourri d’images, pour autant, Amos Gitaï entend faire du visiteur un interprète légitime de tous ces matériaux. Plus qu’un simple consommateur du travail de l’artiste, entre correspondances de sa mère durant la seconde guerre mondiale et photographies découpées et accolées aux murs comme des meurtrières ouvertes sur la foule, c’est au public qu’il incombe de « faire l’histoire ».
Pour venir à bout de ce triptyque, Amos Gitaï a annoncé préparer un livre qui ferait office de synthèse, parce que les mots restent. À travers tous les médiums possibles, l’artiste et réalisateur ébranle l’Histoire, nous montre des frontières poreuses entre réalité et fiction, entre les objets et les images. À une époque de mise en crise des médias et de la banalisation des conflits, pour Amos Gitaï l’art peut encore servir la résurrection de l’oubli historique. Comme disait Christian Boltanski, l’artiste peut et doit poser des questions, à la différence de nombreux philosophes, politiciens ou historiens, il est celui qui ne pense pas avoir de réponses, qui ne pose plus de questions en mots, « mais avec des émotions visuelles ou sonores ».
Amos Gitaï, « Chronique d’un assassinat annoncé », jusqu’au 6 novembre 2016 à la Collection Lambert en Avignon musée d’art contemporain, plus d’informations ici : http://www.collectionlambert.fr/7/expositions/en-cours.html
L’exposition a fait écho à la présence d’Amos Gitaï au Festival d’Avignon dans la Cour d’honneur le 10 juillet 2016 pour son spectacle intitulé « Yitzhak Rabin : chronique d’un assassinat »