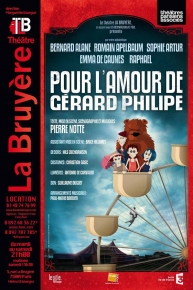Hernani, drame moderne
Cigales, chaleur, temps lourd, c’est dans une ambiance un peu triste de fin de vacances que le Printemps des Comédiens a clos le second chapitre de l’ère Jean Varela. Mais parce que la dernière nuit est souvent la plus belle, le public a pu assister à la création de « Hernani » par la Comédie Française, dans une mise en scène bi-frontale de Nicolas Lormeau.
La voix de Thierry Hancisse introduit le propos en lisant des phrases choisies de préfaces de Victor Hugo, dans un passage, l’auteur définit le drame… Celui-ci doit répondre à l’attente de la foule en l’amusant, du penseur en le conduisant à la méditation et de la femme en lui procurant de l’émotion. Telle est l’ambition d’Hernani. Ce timbre descriptif nous accompagnera durant toute la représentation : c’est elle qui lit les didascalie en début d’acte, comme pour planter le décor.
Un décor magnifique, bien que les comédiens évoluent sur un plateau vide. Grâce aux lumières d’abord, chaque scène est baignée dans une ambiance particulière, irréelle, soulignant le désir d’onirisme voulu par Nicolas Lormeau, des tableaux atteignent une beauté extrême. La musique de Bertrand Maillot complète cette vision, toute en étant discrète, les notes sont importantes, elles soutiennent la mélancolie et le drame aux instants clés de l’action, devenant parfois la septième comédienne de la pièce.
Tout au long de la pièce, on « entend » le texte (sous réserve de ne pas être en haut des gradins, le jeu en extérieur est injuste avec les spectateurs). Les paroles du drame sont vécus, ingérés par des comédiens maîtrisant l’art de la nuance. Les répliques vivent, conformément au désir d’Hugo de briser les règles du théâtre classique, elles sonnent avec un écho de modernité, 180 ans après leur écriture. « Je ne suis qu’un vieux dont les jeunes vont rire ».
Capter les mots
Donner au public la possibilité de capter la beauté des mots, c’est le défi des metteurs en scène contemporains. Faire en sorte que des vers centenaires soient « entendus » aujourd’hui. Le Printemps des Comédiens 2012 a soutenu des créations allant en ce sens. Il n’y a qu’à relire le programme pour réaliser : Le Bourgeois Gentilhomme (m.e.s de Denis Podalydès) ou Antigone (m.e.s de Gwenaël Morin) résonnent avec bien plus de sens que la prose de Brecht (m.e.s par Antoine Wellens).
Dans le « Hernani », Nicolas Lormeau a, en plus, la chance que tous les acteurs soient justes et brillants (mais on en attendrait pas moins du Français!). On sent l’hésitation, le caractère et l’humanité de chaque personnage, ils ne semblent pas de simples comédiens en costume jouant des vies poussiéreuses. On est pris dans leur histoire, les sanglots montant parfois à la gorge ou bien les rires portés par la situation absurde, fort bien mises en valeur. La folie et le désespoir de l’action finale sont bouleversants. Ce couple sublime composé de Félicien Juttner et Jennifer Decker sombre dans un abîme shakespearien réussi, « Voilà notre nuit de noce commencée, je suis bien pâle pour une fiancée », murmure Dona Sol.
Enfin, le metteur en scène a fait le choix de transposer les personnages au XIXe siècle (l’action se situe normalement peut avant le couronnement de Charles Quint en 1519), ce sont donc des gentilshommes en costumes qui sont sur scène et non plus des Grands d’Espagne, les revolvers nous le rappellent souvent.
Ce drame où toutes les actions sont portées par la question de l’honneur souligne la douleur que les hommes ressentent vis à vis (de la plus belle) des femmes. Elle interroge la place du mari et de l’amant sans érotisme tapageur. Victor Hugo savait manier l’élégance des sentiments débarrassés de son animalité.
« Hernani » par Nicolas Lormeau a été créé le vendredi 29 juin 2012 en clôture du Printemps des Comédiens. Il sera repris au théâtre du Vieux-Colombier (Paris VI e) du 30 janvier au 17 février 2013.
Mise en scène : Nicolas Lormeau
Distribution : Catherine Sauval, Bruno Raffaelli, Jérôme Pouly, Félicien Juttner, Jennifer D ecker, et Elliot Jenicot.
ecker, et Elliot Jenicot.