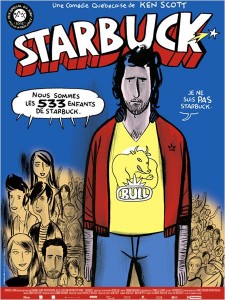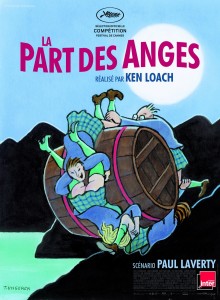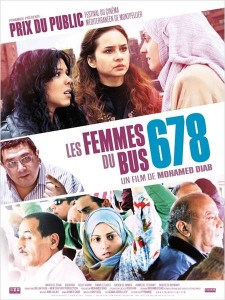PROFIT-ons en!
Quand Machiavel (1) rencontre Don Juan (2) et Dorian Gray (3) dans une multinationale américaine des années 90 ça donne : PROFIT.
Jim Profit (Adrian Pasdar) est le héros en col blanc de cette série co-réalisée par David Greenwalt et John McNamarra par la chaîne FOX. Malgré toutes ces séries qui déboulent sur le marché un petit retour sur cette perle d’une seule saison sortie en 96 n’est pas fortuit.
Une série en costards d’époque
Après quelques images on ne peut que mesurer l’ampleur de l’évolution du monde du travail, évolution visible à l’œil nu. Ce n’était « que » 16 ans plus tôt et pourtant en matière de style et d’accessoires tout semble trop grand, trop gros, trop large si bien que parfois on a l’impression de regarder un film d’époque. Ça ne brûle pas la cornée mais les cravates bariolées irritent tout de même un peu. Les costumes de ces messieurs, les tailleurs de ces dames sont extra-larges et donnent des silhouettes cocasses aux jeunes requins présomptueux qui les portent.
Quant aux vilains (très) gros ordinateurs sans navigateur, ils ne laissent guère présager la bureautique actuelle. Diantre pas d’Internet et une 3D assez folklo, ça fait drôle ! Même la déco des bureaux de Gracen & Gracen pourtant supposés être une société parmi les plus high-tech et grand luxe, prêtent à sourire. Alors quand, au plus fort du suspense, un jingle musical de type vieux rock est lancé à plein tube, là c’est bon on rigole. On rigole mais on est tout de même ostensiblement fasciné car les problématiques soulevées par le personnage principal, elles, n’ont pas pris une ride.
Un précurseur charismatique
 Psychopathe ambitieux et séducteur hypnotique, Jim Profit est le pilier de la série. Il est motivé, intelligent et il ne compte pas ses heures. Il pourra l’écrire sur son CV. Mais s’il devait énoncer des défauts il aurait bien trop le choix…
Psychopathe ambitieux et séducteur hypnotique, Jim Profit est le pilier de la série. Il est motivé, intelligent et il ne compte pas ses heures. Il pourra l’écrire sur son CV. Mais s’il devait énoncer des défauts il aurait bien trop le choix…
Un lien de parenté ténu fait de lui le père ou a minima « le tonton » de bons nombres de personnages au panthéon des séries cultes.
– Un regard acéré sur le monde du travail et les intrigues de bureau.
Don Draper (Mad Men 2007), as-tu changé de costume !?
– Une éthique très personnelle, faites de malversations, chantages, extorsions, intimidations, viles manipulations.
Tony Soprano, serait-ce donc toi (The Sopranos 1999) ?
– Une double vie bien huilée. D’un côté un employé de bureau serviable et de l’autre un homme capable de tuer de sang froid son propre père.
Dexter Morgan (Dexter 2006), n’as-tu donc rien inventé !?
Trop pour l’époque
Jim Profit est un prédateur de la plus vieille espèce, pas un Tricératops, un Tyrannosaure Rex. Il incarne le capitalisme dans sa forme la plus féroce et perverse. Il a les dents qui raient le parquet (et arrachent la moquette) et cache un passé plus que sombre. En ce sens il est repoussant. Il est amoral et mu par sa recherche de vengeance et de pouvoir, mâchoire serrée, bien décidé, il a un but et n’en démordra pas.
Lors des premières diffusions TV,
- Est-ce l’aspect capitaliste extrême qui troubla ?
- Sont-ce les rapports incestueux avec sa mère qui choquèrent ?
- Est-ce que le téléspectateur s’est tristement reconnu dans le personnage avant de le rejeter ?
Nul ne le saura jamais.
Mais, un mythe toujours vivace 16 ans plus tard est intriguant, n’est-ce pas ?
(1) Nicolas Machiavel est un penseur italien de la Renaissance, philosophe et auteur notamment de l’ouvrage Le prince qui regroupe des théories sur la guerre.
(2) Don Juan, célèbre personnage de Molière inspiré à l’origine du Don Juan de Tirso de Molina de 1630.
(3) Dorian Gray, personnage principal du roman Le Portrait de Dorian Gray d’Oscar Wilde, publié en 1890.
Distribution
Adrian Pasdar : Jim Profit
Lisa Zane : Joanne Meltzer
Sherman Augustus : Jeffrey Sykes
Lisa Blount : Roberta « Bobbi » Stokowski
Lisa Darr : Gail Koner
Keith Szarabajka : Charles Henry « Chaz » Gracen
Jack Gwaltney : Pete Gracen
Allison Hossack : Nora Gracen
Scott Paulin : Jack WaltersGracen
Jennifer Hetrick : Elizabeth Gracen Walters
Don S. Davis : l’ancien ShériffMerci à Olivier T. pour cette découverte.