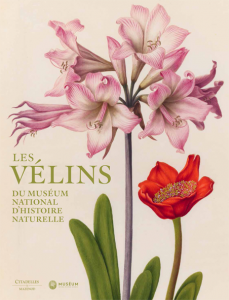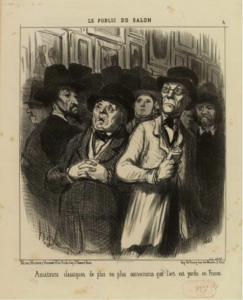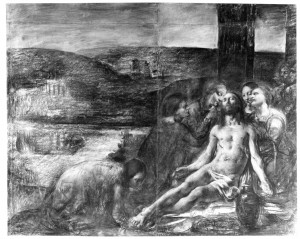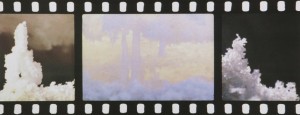Programme détaillé du week-end gratuit :
(Le programme complet est ici téléchargeable sur le site de Paris Musées !)
SAMEDI 10 DÉCEMBRE
MUSÉE D’ART MODERNE DE LA VILLE DE PARIS
Samedi 10 décembre à 16h et dimanche 11 décembre à 16h – A partir de 6 ans sur réservation
Visite découverte en famille
des œuvres phares de la collection
Accompagnées
par un intervenant, parents et enfants partent à la découverte de La Danse
d’Henri Matisse et des œuvres colorées de Robert Delaunay . Une visite
immersion dans les chefs d’œuvres de la collection vécue et partagée en
famille.
Dimanche 11 décembre – 14h, 15h et 16h – À partir de 3 ans – Durée : 1h
Au point Némo, visite et atelier
Parents et enfants découvrent l’installation Point Némo
de l’artiste Laurence Le Deunff en parcourant un environnement coloré agrémenté
de drôle de sculptures. Le visiteur est invité à pénétrer dans un monde aquatique, fantastique et peuplé d’animaux marins bienveillants. L’atelier est une invitation en famille, à imaginer et créer en modelage, les créatures qui semblent s’être enfuies à notre arrivée et dont il ne reste plus que les queues !
MAISON DE BALZAC
15h30 – À partir de 11 ans – Durée : 1h
Représentation théâtrale Le Père Goriot, d’après Balzac
Adaptation pour le théâtre, de l’un des romans les plus connus de Balzac, Le Père Goriot. Dans une mise en scène dynamique, trois acteurs endossent avec virtuosité les rôles féminins grâce au truchement des masques empruntés à la commedia dell’arte. L’adresse de leur jeu oscille entre émotion, poésie et drôlerie. Un dispositif simple qui crée un effet maximum.
Avec Thomas Ganidel, Marc-Henri
Lamande et Didier Lesour.
Mise en scène de Frédérique
Lazarini.
MUSÉE BOURDELLE
de 14h à 17h – À partir de 10 ans – Durée : 3h
Un monument pour la paix
Visite de l’exposition « De Bruit et de Fureur. Bourdelle sculpteur et photographe » suivie d’un atelier de modelage. Comment représenter un symbole, un concept ? Après avoir visité l’exposition temporaire, les apprentis sculpteurs mettent en forme leurs idées et créent une maquette en argile de leur proposition.
MUSÉE CERNUSCHI
11h – Pour les 4 / 6 ans – Durée : 1h30
Perroquets exotiques, visite-animation pour découvrir l’exposition « Walasse
Ting »
S’inspirant des couleurs vives des œuvres de Walasse Ting, petits et grands illustrent des perroquets aux couleurs flamboyantes.
15h et 16h30 – De 5 à 10 ans – Durée : 1h
Spectacle d’ombres chinoises L’enfant magique et le roi dragon
Ce spectacle musical d’ombres chinoises, donné par le théâtre du petit miroir dans l’auditorium du musée Cernuschi, est tiré du Roman de l’Investiture des Dieux. Cette histoire de querelles divines est exclusivement montrée en spectacle avec le théâtre d’ombres. Les ombres chinoises utilisées sont des figurines en peaux finement ciselées, teintées et translucides, qui projettent des ombres colorées sur l’écran.
16h30 – Pour les 6/8 ans – Durée : 1h30
Sauterelles et libellules, visite-animation pour découvrir l’exposition « Walasse
Ting »
Les familles sont invitées à imaginer et faire vivre ces petites bêtes dans une nature foisonnante.
15h – Pour les 9 / 12 ans – Durée : 1h30
Le mot dessiné, visite-animation pour découvrir l’exposition « Walasse
Ting »
À la manière de Walasse Ting, les enfants et leurs parents s’initient de façon ludique et dynamique à la calligraphie.
MUSÉE COGNACQ-JAY, LE GOÛT DU XVIIIe
11h – À partir de 6 ans – Durée : 1h30
La vie quotidienne au siècle des Lumières,
visite-animation
Au cours d’une visite ludique, les enfants et leurs parents découvrent la vie quotidienne au XVIIIe siècle à travers les collections de peintures, sculptures, meubles et objets d’art.
14h30 et 16h – À partir de 6 ans – Durée : 1h30
Mystères au musée,
visite-animation
Guidés par une animatrice, les petits et les grands découvrent les collections tout en aiguisant leur sens de l’observation, et en répondant aux énigmes qui leurs sont posées tout au long de la visite.
CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE DE L’ÎLE DE LA CITÉ
10h30 et 15h – À partir de 6 ans – Durée : 1h30
Dessous-dessus, visite découverte
Après une découverte de la Crypte archéologique, les participants sont invités depuis le parvis à faire jouer leur imagination pour retrouver les traces du passé et imaginer l’atmosphère changeante de l’Île de la Cité au fil des siècles et de ses transformations.
11h – À partir de 8 ans – Durée 1h30
Pile et face, visite dessinée
Des histoires et des monnaies en veux-tu, en voilà pour tout connaître ou presque de la numismatique, avec en prime la réalisation de sa propre planche de monnaies !
14h – À partir de 8 ans – Durée : 1h30
Mission archéo, Visite-animation
De la découverte à l’interprétation, de la préservation à l’exposition, la visite-animation permet de mieux comprendre les enjeux de l’archéologie et de sensibiliser les enfants au métier d’archéologue.
15h30 et 16h30 – À partir de 5 ans – Durée : 1h30
L’île aux trésors, visite contée
Un aventurier accoste sur l’île de la Cité. L’on dit qu’un trésor y est caché… Vieilles pierres ou pièces de monnaie ? C’est l’histoire de Paris qui le dit !
16h – À partir de 6 ans – Durée : 1h30
Visite de l’exposition « L’or du pouvoir »
L’exposition spécialement conçue pour les familles, présente, en regard des vestiges archéologiques de la Crypte, une sélection exceptionnelle de monnaies, témoins matériels de l’histoire de Paris et de son évolution de Jules César à Marianne.
PALAIS GALLIERA
10h – À partir de 8 ans – Durée : 3h
Visite contée et calligramme dans l’exposition « Anatomie d’une collection »
Après la visite contée, les parents et les enfants réalisent un calligramme. Les mots décrivant le vêtement ou l’accessoire d leur choix prendront la forme du modèle choisi.
14h30 – À partir de 13 ans – Durée : 1h30
Visite de l’exposition « Anatomie d’une collection »
Les jeunes et leurs parents découvrent ensemble l’exposition « Anatomie d’une collection ».
MAISON DE VICTOR HUGO
10h et 13h45 – À partir de 6 ans – Durée : 1h
L’art d’être grand-père
11h30 – À partir de 9 ans – Durée : 1h
Notre-Dame de Paris
13h30 – À partir de 9 ans – Durée : 1h
Cosette et Gavroche
15h – À partir de 6 ans – Durée : 1h
Monstres et merveilles
15h – À partir de 9 ans – Durée : 1h
Gilliat le marin
La Maison de Victor Hugo propose un éventail de visite contées pour des petites et grandes oreilles. La poési sera à l’honneur dans les deux thèmes dédiés aux plus jeunes L’art d’être grand-père présente Hugo « papapa » ainsi nommé e décrit par son petit-fils Georges, Monstres et merveilles chez M. Hugo est une balade enchanté à travers les décors imaginés et créés par l’écrivain, plei d’oiseaux merveilleux, mais aussi de lions ou de dragon étranges. Trois autres thèmes de visites contées sont destinées au plus grands offrant le plaisir de plonger dans l’univers de Notre-Dame de Paris, Les Misérables ou Les Travailleurs de la Mer.
MUSÉE DE LA VIE ROMANTIQUE
14h30 – À partir de 6 ans – Durée : 1h30
Visite découverte pour les petits et les grands
Cette visite est l’occasion de découvrir en famille les œuvre phare du musée, mais aussi d’explorer la maison, les atelier et le jardin.
MUSÉE ZADKINE
10h – À partir de 15 ans – Durée : 3h
Mémoire dessinéee, The Hollow Men Atelier dans le cadre de l’exposition De(s)Tin(s) de guerre
Les participants dessinent au trait et à la manière de Zadkine autou de l’œuvre de Chris Marker, hommage au poème de TS. Eliot.
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
MUSÉE D’ART MODERNE DE LA VILLE DE PARIS
14h, 15h et 16h – À partir de 3 ans. – Durée : 1h
Inventer de toute pièce, mini atelier dans l’exposition « Carl Andre »
Carl Andre conçoit des installations qui modulent l’espace. Parents et enfants après avoir visité l’exposition munis d’un livret jeux, son invités à réaliser à partir d’éléments en bois leur propr installation avec l’aide d’une intervenante plasticienne.
16h – À partir de 6 ans – Durée : 1h – Sans réservation.
Visite découverte de l’exposition Carl Andre, Sculpture as place,1958-2010*
Détail de la programmation : voir texte de l’activité du samedi
MAISON DE BALZAC
16h30 – À partir de 11 ans – Durée : 1h – Représentation théâtrale
Le Père Goriot, d’après Balzac
(Détail de la programmation : voir texte de l’activité du samedi)
MUSÉE CERNUSCHI
11h – Pour les 4 / 6 ans – Durée : 1h30
Perroquets exotiques, visite-animation pour découvrir l’exposition « Walasse Ting »
Détail de la programmation : voir texte de l’activité du samedi
15h et 16h30 – De 5 à 10 ans – Durée : 1h
Spectacle d’ombres chinoises L’enfant magique et le roi dragon
Détail de la programmation : voir texte de l’activité du samedi
16h30 – Pour les 6 / 8 ans – Durée : 1h30
Sauterelles et libellules, visite-animation pour découvrir l’exposition « Walasse Ting »
Détail de la programmation : voir texte de l’activité du samedi
15h – Pour les 9 / 12 ans – Durée : 1h30
Le mot dessiné, visite-animation pour découvrir l’exposition « Walasse Ting »
Détail de la programmation : voir texte de l’activité du samedi
MUSÉE COGNACQ-JAY, LE GOÛT DU XVIIIe
11h – À partir de 6 ans – Durée : 2h
Portrait au pastel, atelier
Après l’observation des œuvres de la collection, les enfants e leurs parents sont initiés en atelier à la technique du pastel.
16h – À partir de 6 ans – Durée : 1h
Les Quatre Saisons de Vivaldi
Avec les musiciens de l’Orchestre de Paris, présentation de instruments du quatuor et extraits musicaux des Quatre Saisons de Vivaldi, en écho ave les oeuvres du musée.
CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE DE L’ÎLE DE LA CITÉ
11h – À partir de 8 ans – Durée : 1h30
Mission archéo, visite-animation
Détail de la programmation : voir texte de l’activité du samedi
14h – À partir de 6 ans – Durée : 1h30
Promenade découverte de l’île de la Cité
Le cœur de la capitale dévoile son histoire et ses légendes entr monuments emblématiques et vestiges cachés.
15h30 et 16h30 – À partir de 5 ans – Durée : 1h30
L’île aux trésors, visite contée
Détail de la programmation : voir texte de l’activité du samedi
16h – À partir de 6 ans – Durée : 1h30
Visite de l’exposition « L’or du pouvoir »
Détail de la programmation : voir texte de l’activité du samedi
MUSÉE DU GÉNÉRAL LECLERC DE HAUTECLOCQUE ET DE LA LIBÉRATION DE PARIS /
MUSÉE JEAN MOULIN
11h et 14h30 – 7/10 ans – Durée : 2h
Fabriquer ses jouets avec le « système D »
À la manière des parents et enfants imaginatifs durant la Seconde Guerre mondiale, les participants fabriquent au musée leurs propres jouets avec des matériaux de récupération.
PETIT PALAIS
10h et 16h – À partir de 5 ans – Durée : 1h30
Visite-animation À la chasse aux anges
Tous les anges ont des ailes, mais toute créature ailée n’est pas ange. Pour le vérifier, les enfants partent à leur recherche dans les œuvres. Pour finir, chacun dessine le sien et repart avec une plume d’ange véritable.
14h – À partir de 5 ans – Durée : 1h30
Mon premier atelier au musée
Pour les artistes en herbe, sensibilisation à l’espace du musée, à son architecture et aux œuvres, avec une mallette ludique et sensorielle. En atelier, réalisation d’une carte souvenir « pop up », en papier, dessin et collage.
MUSÉE DE LA VIE ROMANTIQUE
11h, 12h, 14h, 15h et 16h – À partir de 5 ans – Durée : 1h
Contes d’hiver, contes des pays froids, visite contée
Loin d’ici, dans les forêts avoisinantes, les flocons tombent du ciel. Bientôt, tout sera blanc et le vent glacial soufflera… Petits et grands, vous viendrez en famille vous réchauffer en écoutant de belles histoires à l’approche de Noël.
MUSÉE ZADKINE
11h – À partir de 15 ans – Durée : 4h30
Mémoire gravée, The Hollow Men. Atelier dans le cadre de l’exposition De(s)Tin(s) de guerre
Parcours-discussion dans l’exposition, suivi d’un atelier d’initiation à la gravure autour du poème de TS. Eliot, The Hollow Men.
L’atelier se déroulera avec le même groupe de 11h à 12h30 au musée Zadkine puis de 13h30 à 16h30 à l’atelier du musée Bourdelle.)