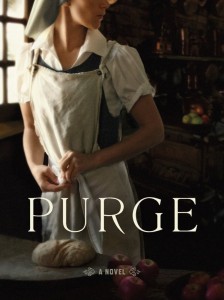« Le Capital et son singe » : leçon théâtrale d’économie
On retrouve pour « Le Capital et son singe », le même dispositif scénique utilisé dans « Notre Terreur » : le public est installé sur deux gradins latéraux, autour d’un espace central où se déroule l’action, de part et d’autre d’une table autour de laquelle dialoguent des personnages historiques.
« Notre Terreur » nous transposait en 1793. « Le Capital et son singe » traverse trois époques : la Révolution française de 1848, la création de la République de Weimar, et un temps indéfini où de grandes figures se rencontrent.
C’est dans l’un de ces moment imprécis que débute le spectacle. Le même acteur incarne Brecht, Freud et Foucault dans une performance multiple de haut vol. Il est, à lui seul, un manifeste du « Verfremdungseffekt » de Brecht. Par ce dispositif, l’homme de théâtre – en marxiste convaincu – remet en question la représentation bourgeoise qui découle selon lui du jeu aristotélicien. Ce début en aparté plante le décor idéologique du spectacle : de la distance, le spectateur va être invité à en voir partout : dans le jeu comme dans les idées.
L’action dramatique débute, elle, à la veille de la manifestation du 15 mai 1848. La réunion fictionnelle qui occupe l’espace scénique réunit Auguste Blanqui, Friedrich Engels, François-Vincent Raspail, Armand Barbès, l’ouvrier Albert ou encore Louis Blanc. Ces hommes (et quelques femmes), sont plongés dans une dispute imaginée qui est prétexte à une mise en opposition des idées de chacun, parfois jusqu’à la caricature.
Puis, le temps d’un repas de noce, le public est transporté à Berlin en juin 1919. A table, on parle de la mort de Rosa Luxemburg, de son héritage, de la nécessité de descendre manifester dans la rue. Prenant des airs un peu fantastiques, apparaissent tour à tour Spartacus, puis Ophélie de Shakespeare. L’effet du schnaps qui coule abondamment à table, peut-être…
Enfin, on revient en 1849 au procès de Bourges où l’ouvrier Albert se transforme en Lacan face à Freud, pendant que Lamartine est à la table du jury. Toutes ces rencontres présentent un mélange historique anachronique comme seul le théâtre sait le rendre aussi captivant.
Durant les 2h30 que dure le spectacle, on assiste à une tentative de vulgarisation de concepts principalement économiques. Des mots, difficiles au premier abord, sont suffisamment bien amenés pour que chacun les comprenne. Et quand l’hermétisme pointe son nez, cela en devient presque drôle.
Par l’utilisation d’un langage moderne et populaire (pour « Notre Terreur », certains ont reproché à Sylvain Creuzevault des fautes de français que ces personnages historiques n’auraient jamais commises), il y a un humour certain, reposant surtout sur l’anachronisme et l’exagération des idées et des protagonistes. On pense notamment au chimiste Daniel Borme, joué par Léo-Antonin Lutinier, qui est ici un personnage new-age, candide de la Révolution et ballerine à ses heures perdues.
« Le Capital et son singe » est un théâtre distancé à la mise en scène astucieuse, où sous l’apparence de conversations à huis-clos, se tiennent en fait des scènes hautement pédagogiques, créant un questionnement vrai sur le monde d’aujourd’hui : le travail d’Etat n’occupe-t-il pas des gens à ne rien faire ? L’homme n’est-il pas réduit à l’état de simple marchandise ? Ne sommes nous pas chosifiés ? Quelle différence y a-t-il entre prix et valeur ? Quelle place prend l’objet au détriment de la relation humaine ? Ou comment sont conditionnées lesdites relations par des rapports sociaux et sociétaux ? Malgré le « foutoir » apparent, ce « Capital » porte un propos bien défini et passionnant.
« Le Capital et son singe » d’après Karl Marx, au Théâtre de La Colline jusqu’au 12 octobre, 15 rue Malte-Brun (20e arrondissement), le mardi à 19h30, du mercredi au samedi à 20h. Dimanche à 15h. Durée : 2h30. Plus d’informations sur www.festival-automne.com/.