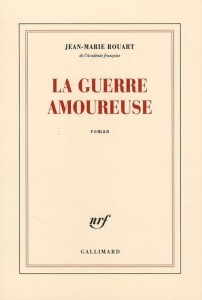[Cinéma] Moi, Tonya

Courte mais intense, la carrière de la patineuse Tonya Harding inspire tumulte et violence au réalisateur Craig Gillespie (Une Fiancée pas comme les autres ou The Finest Hour). Si Moi, Tonya ne semble ni savoir où aller ni quoi nous dire, c’est peut-être pour coller à l’image d’une héroïne paumée.
Tonya Harding c’est d’abord une petite fille qui ne se remettra jamais du départ de son père, elle se crèvera d’entraînement pour la seule chose qu’elle sait faire : patiner. Adolescente en lutte éternelle contre elle-même, elle va quitter très tôt une maison toxique. Malmenée par une mère qui la frappe, la rabaisse, elle se barre à quinze ans, barbelé sur les dents avec un mec violent qui la cogne, lui aussi. Si elle sait se défendre avec son effronterie, elle maquille ses bleus dont elle a tant besoin. On la bat et cela la booste, elle rappellera même Jeff, devenu son ex-mari, la veille d’un championnat, tant elle a besoin de coups pour se remotiver.
Mais pour qu’un scénario patine si lourdement, c’est qu’entre portrait, enquête, psychologie de comptoir ou simple tranche de vie, on ne sait pas où cela va. Qu’est-ce qu’un biopic qui balaie en trois dates et pas plus de scènes sur la glace, une carrière si houleuse ? Même si Margot Robbie excelle autant sur des patins que dans les baskets de la championne, l’histoire est trop brouillonne et part dans tous les sens. Sur une pseudo-rythmique d’allers-retours maladroits entre interviews de l’athlète et immersion dans son couple, le spectateur peut se perdre dans un film incomplet. L’envie irrépressible de trouver un documentaire sur la vie de la vedette peut être dérangeante car malgré le titre qui emphase sur le « moi » de Tonya, c’est plutôt sur le reste que la camera se braque. On sort peu renseigné de cette biographie satisfaite de la facette badass du personnage Harding.
L’explosion de sa carrière occupe à peine l’espace dans deux heures assez longues. Cinq minutes à l’écran pour ce coup de matraque qui secoua le monde du sport ainsi que toute la presse. Cela semble un poil court pour « l’affaire Harding-Kerrigan » que l’on ne présente plus, mais surtout mal jaugé pour l’instant fatidique qui fit basculer toute entière la vie d’une championne. Depuis qu’elle a trois ans elle s’exerce sur la glace mais c’est sur à Lillehammer qu’elle patinera hélas pour la dernière fois. Retour en 1994 quand les JO d’hiver se déroulaient en Norvège et que Tonya Harding amorçait son épreuve : le fameux programme court. Celle qui fut la première, femme et américaine à réaliser un triple axel est sous une pression monstre. Un lacet qui la gêne, elle demande au jury une seconde chance sur la piste : ils acceptent mais elle chute, et à plusieurs reprises. Dommage que Gillespie n’ait fait que survoler ce passage crucial… Trop déstabilisée par les soupçons qui pèsent sur elle et son entourage à propos de l’attaque de Nancy Kerrigan, adversaire éternelle, elle finira 10e. Alors que sa rivale blessée six semaines plus tôt décroche sur le podium la médaille d’argent, Harding est détrônée mais aussi démasquée comme complice dans cette histoire de coup-bas aux vestiaires.
Sans grande surprise alors un spectateur peut facilement se laisser aller à moult rebondissements. D’autant que le réalisateur ne manque pas de faire de l’humour, mais cela ne suffit pas pour que le film se tienne. Néanmoins on comprend, par un formidable finish, que la danseuse brutale va se reconvertir. Peu svelte sur la glace elle sautille sur un ring puisqu’elle choisit la boxe. Petite fille battue mais pas des moins robustes, on saisit (bien trop tard!) une femme inébranlable, et la boucle est bouclée.
« Moi, Tonya » de Craig Gillespie, sortie au cinéma le 21 février 2018
Tonya Harding : Margot Robbie (sélectionnée pour l’Oscar de la meilleure actrice)
LeVona Fay Golden : Allison Janney (Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle)
Jeff Gilooly : Sebastian Stan